LE BLOG RED-ON-LINE
Entreprises et santé : êtes-vous vraiment prêt pour la canicule ?
- #canicule
- #changement climatique
- #entreprises et santé
- #gestion du risque
- #mise en conformité HSE
- #prévention
- #QVT
- #rechauffement climatique
- #Red-on-line
- #risques professionnels
- #santé au travail
- #santé et sécurité
- #Santé publique
- #william dab
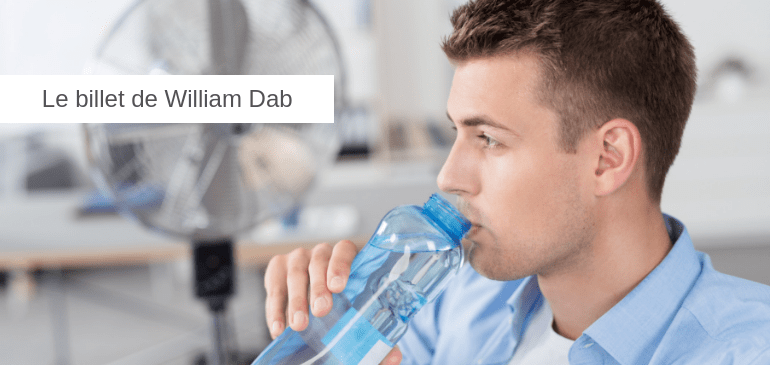
Alors que les températures vont atteindre des sommets inédits pour un mois de juin, la mobilisation générale à tous les…
Alors que les températures vont atteindre des sommets inédits pour un mois de juin, la mobilisation générale à tous les niveaux de la société contraste avec la passivité qui avait marqué l’épisode de 2003 et son terrible bilan. Cette mobilisation concerne aussi les entreprises. Même si les risques des personnes âgées sont les plus élevés, les fortes chaleurs peuvent affecter les employés. Les entreprises ont-elles pleinement tiré les leçons des épisodes précédents ? Ce n’est pas sûr.Un meilleur diagnostic
Une première leçon tirée de l’échec de 2003 est l’amélioration des prévisions météorologiques. Dès le 21 juin, Météo-France a lancé l’alerte, offrant ainsi un temps précieux pour se préparer à faire face au risque. Cette efficacité concerne également le système de santé publique et tous les acteurs de la prévention. Nommé directeur général de la santé le 20 août 2003 après la démission de mon prédécesseur (et ami) Lucien Abenhaim, j’ai reçu du ministre chargé de la Santé, Jean-François Mattei, une lettre de mission qui me chargeait de préparer des plans de réponses aux situations d’urgences sanitaires, notamment celles d’origine météorologique (pics de chaleur, vagues de froid, inondations, tempêtes, etc.). La préparation du plan « canicule » a alors permis de révéler la grande erreur commise lors du terrible épisode de 2003 : avoir considéré qu’il s’agissait d’un problème d’insuffisances de moyens aux urgences hospitalières. Il y avait là une erreur d’analyse de signal : en réalité, les trois quarts des décès étaient survenus au domicile. La canicule n’est pas un risque qu’il faut prendre depuis l’hôpital. Quand les malades arrivent à l’hôpital, c’est trop tard. Il faut pouvoir agir en amont.Une meilleure surveillance
En matière de sécurité sanitaire, la canicule de 2003 a marqué une autre rupture. L’Institut de Veille sanitaire (InVS), aujourd’hui Santé Publique France, a considérablement renforcé ses outils de surveillance de la santé (mortalité, morbidité, activité médicale…) en temps réel. De nombreux plans de réponses aux alertes et aux urgences ont ainsi été élaborés, testés et évalués. Pendant tout le mois d’août 2003, la controverse avait porté sur les estimations divergentes du nombre de décès. En réalité, tout le monde avait tort. Même les plus alarmistes étaient bien en dessous de la réalité. À l’époque, on peut considérer que le dispositif de pilotage des actions de prévention était aveugle. On mesure le chemin parcouru.Quelles leçons pour la santé au travail ?
Pour parer aux conséquences sanitaires de la canicule, le dispositif public comporte donc :- Une surveillance permanente des signaux météorologiques et sanitaires.
- Un dispositif de mobilisation des très nombreux services et professionnels sanitaires et sociaux qu’il faut mobiliser pour éviter que les personnes (surtout les personnes âgées) ne meurent de coup de chaleur ou de déshydratation à leur domicile. Une telle organisation ne peut pas s’improviser. Elle doit être préparée.
- Une implication de tous pour être attentif à sa santé, à celle de ses proches, de ses voisins, etc.
- Une capacité d’agir sur le terrain avec la possibilité donnée aux personnes fragiles de se faire connaître des services municipaux qui peuvent veiller sur eux.
- Une évaluation des épisodes caniculaires pour créer un cercle vertueux d’amélioration continue.
- Une cartographie globale des risques (voir mon précédent billet) couplé à des dispositifs de vigilance.
- Des actions de prévention organisées en mode projet.
- Une culture partagée de la prévention pour que chacun se sente impliqué et acteur.
- Des moyens d’actions dédiés et coordonnés.
- Une évaluation systématique permettant d’améliorer l’efficacité des actions.
 Professeur titulaire de la chaire d’Hygiène et Sécurité du Cnam où il forme des spécialistes des risques sanitaires du travail et de l’environnement, notamment par une filière d’ingénieur en gestion des risques, William Dab est médecin et docteur en épidémiologie. Sa carrière a été entièrement consacrée à la sécurité sanitaire qu’il s’agisse d’outils d’évaluation, de surveillance et de gestion des risques. Ancien directeur général de la santé, il a été membre du comité exécutif de l’OMS et président du comité européen environnement et santé pour la région Europe de l’OMS. Il a notamment publié « Santé et environnement » dans la collection Que sais-je ? (PUF) et « La Santé et le Travail » chez Arnaud Franel.
Professeur titulaire de la chaire d’Hygiène et Sécurité du Cnam où il forme des spécialistes des risques sanitaires du travail et de l’environnement, notamment par une filière d’ingénieur en gestion des risques, William Dab est médecin et docteur en épidémiologie. Sa carrière a été entièrement consacrée à la sécurité sanitaire qu’il s’agisse d’outils d’évaluation, de surveillance et de gestion des risques. Ancien directeur général de la santé, il a été membre du comité exécutif de l’OMS et président du comité européen environnement et santé pour la région Europe de l’OMS. Il a notamment publié « Santé et environnement » dans la collection Que sais-je ? (PUF) et « La Santé et le Travail » chez Arnaud Franel.